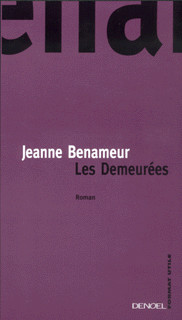
(Luce, premier jour d’école.)
Le soir, Luce est revenue. Elle s’est dressée. Les deux grandes mains à plat, appuyant, elle s’est assurée du corps de la petite. Et comme un sourire. Mais Luce a détourné la tête. Elle s’est esquivée vers le cartable usé donné par la maîtresse, en a sorti un cahier fin, un crayon et une règle. La Varienne a reculé.
La petite est installée au bout de la table. À coup de boucles et de traits, elle lie parti avec le monde, hésitante. Brusque, La Varienne a retrouvé les gestes pour la soupe du soir. Elle garde l’écart. Les tracés malhabiles de la petite sur le cahier suffisent à la tenir à distance, comme une bête effrayée par le feu.
Elle rôde, n’approche pas trop près l’assiette de soupe fumante.
La petite est une reine solitaire. Elle continue son ouvrage, finit par ranger ses instruments de distance dans le cartable. Sa mère ne met pas l’assiette là où était posé le fin cahier aux lignes bleues. Luce attire à elle la nourriture, apprenant sans joie le pouvoir de manquer.
[…]
Elle chasse très loin l’image de la bouche marmonnante qui ne sait pas répondre haut et clair aux paroles de la maîtresse. Elle chasse toute la journée. Elle n’apprendra rien. Rien et rien. Elle restera toujours avec sa Varienne. Toujours. Et des larmes coulent qu’elle n’essuie pas pour ne pas la réveiller, elle qui semble endormie sitôt couchée.
Aucune ne dort.
[…]
Pour Luce, une étrange vie a commencé.
À l’école, elle est une élève. Mais elle n’appartient pas.
Reliée à personne : ni à ses condisciples, ni à Mademoiselle Solange, l’institutrice. Elle a passé alliance avec les murs dont elle connaît le fendillement, la couleur qui peu à peu se détourne du nom net de la première couche brillante pour atteindre, le temps aidant, une teinte qu’on ne définit plus.
Dès que les paroles claires de Mademoiselle Solange menacent de pénétrer à l’intérieur d’elle, là où toute chose pourrait se comprendre, elle fuit. D’une enjambée muette, elle se niche où le plâtre du mur se délite, au coin de la grande carte de géographie, près du bureau.
Entre les grains usés, presque une poussière, elle a sa place. Elle fait mur. Aucun savoir n’entrera. L’école ne l’aura pas.
Elle demeure. Abrutie, comme sa mère. Aimante et désolée.
Mademoiselle Solange a beau la rappeler de sa voix douce, elle échappe. Ses doigts serrent plus fort le porte-plume, son regard se prête à nouveau à celui, interrogateur, de l’institutrice. Elle n’est pas là. Elle n’est pas là. Elle donne juste les signes convenus, appris d’instinct, pour qu’on la laisse tranquille. Bien malin celui qui saurait la dénicher dans la fente du mur d’où elle n’entend plus rien, à l’abri, d’où chaque être devient un objet lointain, à peine animé. À l’abri.
Non, elle ne rêve pas. La maîtresse peut continuer, tranquille, sa leçon. C’est bien plus qu’un rêve : elle vit. Elle fait corps avec le salpêtre, le plâtre en déroute. Elle est poussière, de son vivant poussière.
Et Mademoiselle Solange ne comprend rien. Comment une petite fille si sage peut-elle rester à ce point ignorante ? Mademoiselle Solange a voué sa vie à combattre les préjugés des esprits courts, «telle mère, telle fille ». La petite pose une énigme qu’on ne résout pas.
Devant les autres, elle ne l’interroge plus, pensant que les rires à peine étouffés de ses condisciples la condamnent d’avance au silence.
Elle attend la fin de la journée. Quand la petite a fini de ranger ses affaires, toujours après les autres tant sa lenteur face aux objets est tenace, renouvelée, elle s’approche doucement et lui parle. Mais l’enfant entame sa marche vers la grille de l’école. Rien ne semble pouvoir l’arrêter. C’est un pari difficile de la retenir, un peu, à la porte de la classe, puis de lui faire ralentir le pas dans la cour où des enfants bruyants se poursuivent encore.
Mademoiselle Solange l’escorte jusqu’à la rue et marche près d’elle. Pourtant, elle sent l’impatience dans les jambes de la fillette dès la porte de la classe passée. Vers quoi veut-elle aller si vite ?
La petite répond à voix basse aux questions de l’institutrice. Oui, elle demandera si elle ne comprend pas. Oui, elle essaiera d’apprendre ses leçons. Oui, oui et oui. Qu’on la laisse partir ! Qu’on la laisse partir ! C’est tout ce que disent les pieds qui martèlent le sol.
L’institutrice la regarde se hâter sur le chemin, referme la grille lentement, désemparée face à quelque chose qu’elle sent immense, à quoi elle n’a pas accès. Elle rentre en serrant son châle sur ses épaules. Sur son front, le souci.
Les gestes de Mademoiselle Solange quand elle ramasse les cahiers sur les pupitres ont alors l’engourdissement de qui ne comprend pas.
La petite court vers la maison. Sur le chemin déjà elle égrène les mots qui ont réussi à occuper une place dans sa tête. Il faut garder le vide. Elle chante une étrange chanson où se mêlent toutes les leçons de Mademoiselle Solange. Luce a retenu les mots. Mademoiselle Solange les dit, les répète si doucement.
Elle chante sur le chemin. Les mots s’accrochent aux branches des arbres. Les mots tombent dans la boue et s’enfonceront bien loin, sous les roues, sous les pas pesants qui les colleront à la terre bien noire. Il faut.
Elle court.
À la maison, les choses de l’école qui restent encore dans la tête s’en vont vite, chassées par le torchon de La Varienne, comme la buée sur les vitres, la vapeur qui s’échappe du faitout.
Elle est entrée. Elle a poussé la porte. Elle se coule entre les gestes de la mère, ne l’effarouche pas, se glisse, subreptice, dans la maison. Parfois La Varienne l’attend, debout, glacée. Luce va alors jusqu’à elle sans la regarder. Les grandes mains plates descendent sur le petit corps qui ne s’échappe pas. Qui vive ! Luce, à nouveau reprend sa place à table.
Elle ne sort plus rien de son cartable. Elle le laisse près de la porte. L’école n’existe pas.
Entre la mère et la fille, le pacte. Total.
Benameur, J. (2002). Les demeurées. © Éditions Denoël.
